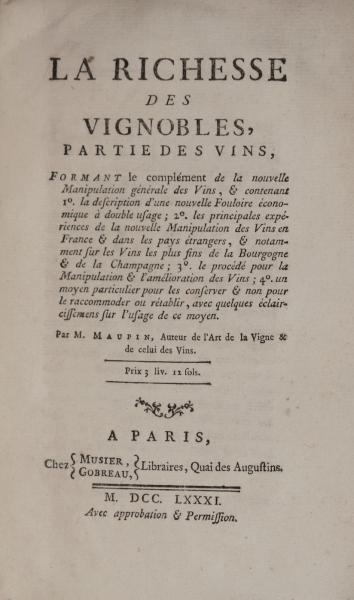Étienne Chevalier (1750-1828) est vigneron à Argenteuil lorsque la Révolution éclate. Député aux États généraux de 1789, il sera membre de l’Assemblée Constituante. Malgré cette activité qui ne devait pas être de tout repos, il continue son métier d’origine qu’il cherche à perfectionner. Comme Maupin, il est conscient de la médiocre qualité des vins de son époque mais, comme Maupin, il refuse d’y voir une fatalité. Il met en pratique les préceptes de Maupin : protéger les raisins et les moûts de l’air, chauffer le moût pour soutenir la fermentation. Il insiste sur la nécessité de finir tranquillement la fermentation avant d’écouler le vin, le temps que la fermentation se propage dans toute la cuve, alors qu’on pense à l’époque que la fermentation la plus rapide est la meilleure. Les travaux de Chaptal l’impressionnent et pratique l’enrichissement des moûts au sucre pour élever le degré d’alcool et compenser le manque de maturité des raisins lié au climat. Mais surtout, il met l’accent sur le soin qu’il faut apporter à la vinification. Si ce précepte semble évident aujourd’hui, il ne l’est pas à l’époque où l’on pense que si on fait le vin vite, il sera meilleur car il aura moins d’occasions de se gâcher. « C’est l’art qui fait le vin », dit-il. Beau précepte dans lequel de nombreux vignerons d’aujourd’hui se reconnaissent.
Faisant d’une pierre deux coups, il profite de sa présence à l’Assemblée pour défendre les vignerons devant ses collègues. En 1790, il monte à la tribune pour tonner contre l’effet néfaste des taxes excessives qu’ils doivent supporter et impute la médiocre qualité des vins des alentours de Paris à la pression fiscale, qui oblige les vignerons à produire des quantités importantes de vins pour gagner leur vie, au détriment de la qualité du produit. Il faut croire qu’il a touché au cœur les vignerons d’Argenteuil car ceux-ci l’élisent maire l’année suivante.